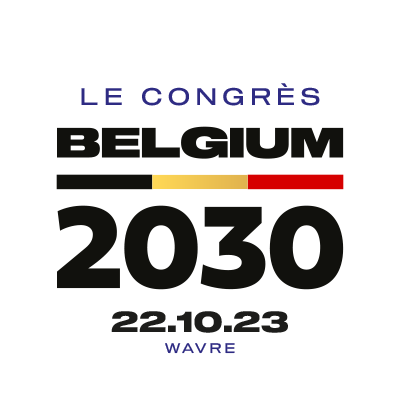Travailler l'avenir
Dotons la Belgique d’un projet porteur et d’avenir pour ses 200 ans en 2030
Les élections de 2024 seront décisives pour l’avenir de notre pays. Le MR se met en ordre de marche et vous invite à débattre et voter des nouvelles propositions du MR pour la Belgique lors de notre Congrès Belgium 2030 ! Les propositions pour lesquelles vous voterez seront intégrées dans notre programme, raison pour laquelle seuls les membres en ordre de cotisation pourront voter.
Vous pouvez placer vos amendements en vue du congrès..
Programme
09h00 Accueil des participants et animation pré-congrès
10h00 Congrès
12h00 Verre de l’amitié et ouverture de l’expo-market Belgium’s got Talents
12h30 Ouverture du bar et des foodtucks (jusque 14h30)
Lunch
Un repas est compris par réservation. Possibilité d’acheter des repas enfants / accompagnants sur place.
Inscrivez-vous !
Infos pratiques
La Sucrerie
Chemin de la Sucrerie 2
1300 Wavre
Accès
TRAINS
Gare SNCB à 500 m, ligne 139 (Ottignies – Leuven) – belgiantrain.be
BUS
Gare TEC à 500 m – letec.be
EN VOITURE
Accès facile depuis la E411
PARKINGS privatisés et gratuits
Parking 1 ERMITAGE & Parking 2 SUCRERIE
Total 350 places